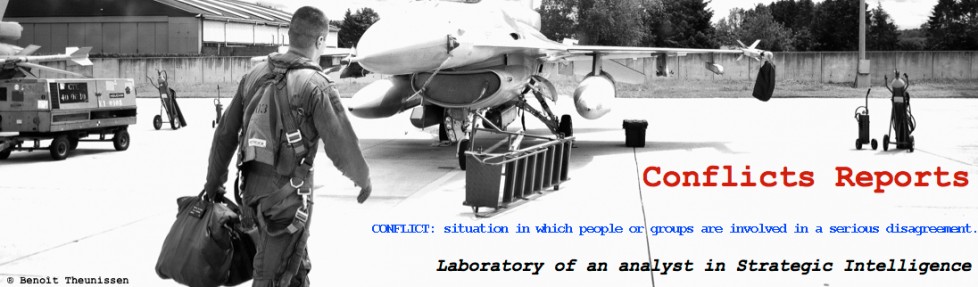L’Afrique n’est pas reconnue pour ses entreprises. C’est vrai, il y en a peu. L’économie du continent est aux mains des investisseurs étrangers. Beaucoup d’entrepreneurs africains rêvent d’une Afrique des capitaux autonome et indépendante.
Pour lire l’article en PDF: L’esprit d’entreprise au service de l’Afrique
Le 17 septembre dernier, la société congolaise VMK a jeté un lourd pavé dans la mare des constructeurs de technologies de l’information et de la communication (TIC). En levant le voile sur la première tablette tactile africaine, appelée « Way-C » (qui signifie Lumière des Etoiles dans un dialecte au Congo), Vérone Mankou, le président de l’entreprise VMK, a montré au monde entier le potentiel des entreprises africaines. Le but de cette nouvelle tablette tactile est de favoriser pour les Africains l’accès à Internet via un appareil à moindre coût. Le prix d’achat de la « Way-C » s’élève à 150.000 francs CFA (à peu près 229 euros). Ce qui la rend très compétitive par rapport aux autres produits de ce segment du marché des TIC. L’annonce de la commercialisation de leur nouveau produit a permis à l’entreprise VMK de mettre un terme à tous les doutes qu’ont pu émettre leurs détracteurs. « Certains croyaient qu’on ne pouvait pas développer une tablette tactile en Afrique, sinon on ferait la copie. (…) Nous avons voulu montrer qu’on pouvait faire quelque chose en Afrique. », a déclaré le PDG de VMK. Après ça, qui osera encore répliquer à cet homme qui a concurrencé Apple que les entreprises africaines n’ont aucun potentiel?
Des success stories africaines
Le continent africain n’est pas réputé regorger de grands entrepreneurs et autres célèbres industriels tels Richard Branson ou encore Arnaud Lagardère. L’Europe et les USA lui ont peu volé la vedette. Et maintenant, c’est progressivement au tour de la Chine émergente de faire monter au créneau ses nombreux capitaines d’industries. Pourtant, beaucoup d’Africains ont connu et connaissent encore des success stories. A vue d’oeil, il est facile de citer le cas de Yerim Sow, fortement présent dans le secteur africain de la téléphonie mobile depuis 1994. Actionnaire majoritaire de Teylium Telecom, il vient d’investir dans la construction d’un réseau GSM au Cap-Vert pour un coût total de 9,5 millions d’euros. Il est aussi très actif en Sierra Leone, au Liberia, Mali et bien d’autres pays du continent noir. Il devrait également bénéficier d’un financement de 23 millions d’euros de la Société Financière Internationale (SFI), groupe de la Banque Mondiale, pour ériger un hôtel cinq étoiles à Dakar.
Le burkinabé Lassiné Diawara fait également partie du « club » des grands entrepreneurs d’Afrique. Il s’est lancé dans les affaires à la fin des années 1980. « Je me suis vite rendu compte qu’il y avait un créneau délaissé dans le pays », a expliqué ce véritable tycoon. Une majorité d’entrepreneurs burkinabés refusaient d’investir dans le capital d’une société s’ils ne devenaient pas maîtres de son management. Lassiné Diawara doit son empire financier à cette simple constatation. « Je les ai alors pris à contre-pied, n’hésitant pas à travailler pour des filiales de grands groupes occidentaux », a-t-il décrit. Il est alors parvenu petit à petit à pénétrer l’actionnariat de ces entreprises étrangères.
A côté d’une poignée de grands, une immensité de petits
« Ceci n’est pas une africaine qui souffre de la faim. C’est la gérante d’une coopérative agricole. » pouvait-on lire en février 2011 en-dessous d’une publicité magazine de l’association française CCFD-Terre Solidaire qui montrait l’image d’une femme en habits traditionnels d’Afrique, avec un enfant dans les bras et un sac de manioc à côté d’elle. CCFD-Terre Solidaire lançait alors une campagne de lutte contre les clichés de l’Occident sur le Sud. La publicité de cette campagne va plus loin que les simples stéréotypes. Elle rappelle que les petits agriculteurs et producteurs du Sud ont besoin de fonds financiers pour monter de petites structures locales.

Une partie de cette force productive bénéficie de micro-crédits. L’Organisation des Nations Unies considère le micro-crédit comme l’un des outils les plus efficaces pour améliorer les perspectives économiques et lutter contre la pauvreté en Afrique. L’ONU a lancé en 2005 l’année internationale du micro-crédit. Ce projet s’est inscrit dans l’Objectif de Développement du Millénaire de la réduction de la pauvreté. Aujourd’hui, le développement des secteurs financiers dans les pays en voie de développement est devenu l’une des priorités majeures de l’ONU. S’il y a (trop) peu de petites entreprises, ce n’est pas à cause d’un manque de volonté, mais bien d’argent et de formation. Pour certains habitants du continent africain, entreprendre est un question de survie.
Et pour aller plus loin:
Le peu de structure financière, un frein aux petites entreprises
L’Afrique est un marché financier qui ne s’est pas encore bien structuré. Cet état constitue un véritable obstacle au bon fonctionnement du système des micro-crédits. A côté de l’Asie et de l’Amérique latine, le marché du micro-crédit africain est victime d’un important retard au niveau des volumes engagés par le secteur privé. Les chiffres relatifs à la situation financière des particuliers sont déplorables. Ils montrent qu’à peine 4% de la population africaine possèdent un compte bancaire et seulement 1% a obtenu un prêt ou tout autre forme de crédit auprès d’une institution financière officielle. L’Afrique est la seule région du monde où une aggravation de la pauvreté est prévue. Il est donc plus qu’urgent que les populations aux plus petits revenus aient accès de manière globale à des systèmes financiers jouant pleinement leurs fonctions.
La bidouille des petites entreprises
Les législations en matières d’emploi et de travail de certains pays en voie de développement ne sont pas toujours à l’avantage de ceux qui souhaitent exercer leur activité professionnelle sous le statut d’indépendant. Des administrations trop souvent sous la coupe de la corruption et des procédures longues et fatigantes en rebutent plus d’un à se lancer dans les demarches pour devenir indépendant. Beaucoup se retrouvent obligés d’outrepasser la loi et de travailler au noir. Ils choisissent l’économie informelle. Utilisée pour désigner une part de l’économie des pays en voie de développement, l’économie informelle regroupe d’une part, l’économie souterraine du pays et d’autre part, les activités illégales de celui-ci. Au Maroc, le Haut Commissariat du Plan a réalisé une enquête en 2007 sur un échantillon de la population. Selon cette enquête, le territoire compterait 1.550.274 unités de production informelles. Il s’en formerait près de 40.000 par an.
A quand une Afrique autonome?
Il y a beau y avoir des entreprises innovantes en Afrique, la majorité d’entre elles restent dépendantes des investissements et infrastructures étrangères. Le continent africain ne brille certainement pas par ses exportations. Selon un rapport de l’Organisation Internationale du Travail, les exportations de l’Afrique subsaharienne représentaient en 2008 seulement 2,2% des exportations mondiales totales. Le chiffre est pire pour l’Afrique du Nord: à peine 1,1%.
Beaucoup ont douté de l’aboutissement de la tablette tactile « Way-C » de l’entreprise congolaise VMK. Tous les détracteurs ont qualifié ce projet d’idée folle. « Ce projet a fait couler beaucoup d’encre (…) Parce qu’on n’a pas les moyens et qu’il n’y a pas d’infrastructures en Afrique », a déclaré Vérone Mankou, PDG de VMK, en septembre 2011 à Brazzaville. Ce nouveau modèle de tablette graphique a été imaginé par des cerveaux africains, mais est actuellement fabriqué en Chine. La région de l’Afrique noire ne connait encore aucune entreprise d’exportation de matériels informatiques. La création d’une entreprise locale qui fabriquerait la « Way-C » en Afrique nécessiterait un apport financier d’environ 2 millions d’euros, une “bagatelle” pour ses concurrents… Une somme pourtant introuvable pour des entreprises comme VMK.
Le continent africain a connu un rebond de croissance durant la dernière décennie, mais il n’a pas été suffisant pour résorber la pauvreté, le chômage et le sous-emploi. Les mouvements du Printemps arabe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ont mis en evidence l’urgence pour les pays de ces régions du globe de créer des emplois et trouver des solutions pour relancer leurs économies respectives.